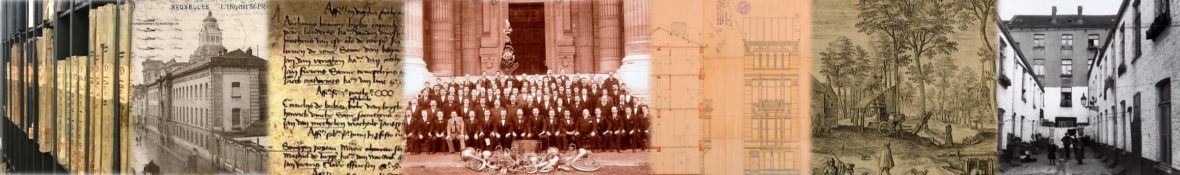Aux portes de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine se trouve Meudon[1]. Elle est entourée par les villes de Clamart, Velizy, Chaville, Issy-les-Moulineaux et Sèvres. Les premiers vestiges du village remontent au VIe siècle. Les abbés de Saint-Vincent[2] possèdent alors une partie du territoire. Au XIIe siècle le seigneur Erckembold donne son blason à la… Continue reading Meudon : son histoire et son jumelage avec Woluwe-Saint-Lambert
Houffalize-Schaerbeek, une amitié de longue date
Après le débarquement de juin 1944, les Alliés avancent progressivement et libère les villes européennes occupées par les Allemands depuis mai 1940. Le 25 août 1944, Paris a été libérée et les troupes anglo-américaines se dirigent vers la Belgique. Le 2 septembre les alliés franchissent la frontière et libèrent Tournai. À Bruxelles, les Allemands sont… Continue reading Houffalize-Schaerbeek, une amitié de longue date
Le Dr Jean-Baptiste Jourdan : Une richesse à partager
Le docteur Jean-Baptiste Jourdan (1803-1878) fut médecin et philanthrope. Il a effectué ses études de médecine à l'Université catholique de Louvain. Propriétaire terrien et promoteur compétent, c'est avec Jean-Philippe De Joncker qu'il devint l'un des fondateurs de la première rénovation du quartier Louise et de la place Stéphanie après le démantèlement de la seconde enceinte… Continue reading Le Dr Jean-Baptiste Jourdan : Une richesse à partager
Woluwe-Saint-Pierre et ses jumelages
La politique de jumelage de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre a pour objectif de contribuer au développement et à l’amélioration du bien-être des populations concernées par l’échange d’expériences et de connaissances dans les domaines culturel, administratif et économique. La Commune a six jumelages et deux partenariats en Europe (Pecica en Roumanie), en Afrique (Kamonyi au Rwanda… Continue reading Woluwe-Saint-Pierre et ses jumelages
Le Neptunium
Avant le Neptunium, la commune de Schaerbeek avait déjà eu la chance de posséder un bassin de natation public, celui de la rue Kessels. Mais devenu vétuste, celui-ci a fermé en 1940 puis été détruit. Dans les années 30, un projet privé de créer une piscine ainsi qu’une patinoire le long du boulevard Lambermont avait également été mis… Continue reading Le Neptunium
Le centre sportif de Saint-Gilles, ancienne distillerie CUSENIER
Le centre sportif de Saint-Gilles a ouvert ses portes en 1993 et accueille des milliers de visiteurs chaque année. Les curieux remarqueront cependant que le bâtiment est bien plus ancien. Ils peuvent lire « MAISON FONDÉE EN 1881 PAR E. CUSENIER FILS AINÉ » sur une stèle au-dessus de la porte d’entrée. Mais qui était… Continue reading Le centre sportif de Saint-Gilles, ancienne distillerie CUSENIER
KVS : du commerce à l’art, un entrepôt devenu théâtre
Le Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) est le théâtre néerlandophone bruxellois. Il est abrité dans un bâtiment de style néo-Renaissance flamande au nord du Pentagone, au n°7 du Quai aux Pierres de Taille. Avant de devenir un lieu culturel, ce bâtiment a connu d’autres affectations bien éloignées. Au milieu du 18e siècle, le Gouvernement général met… Continue reading KVS : du commerce à l’art, un entrepôt devenu théâtre
Les visages multiples du complexe Fernand Bernier 40 à Saint-Gilles
Au début du XIXe siècle, le complexe Fernand Bernier n’existait pas encore, mais le terrain sur lequel il sera ultérieurement construit, abritait initialement l’abattoir de Saint-Gilles. Les activités d’abattage à Bruxelles étaient bien intégrées à la vie urbaine, puisque des abattoirs spécifiques étaient situés dans le centre de la ville. En 1838, la Ville de… Continue reading Les visages multiples du complexe Fernand Bernier 40 à Saint-Gilles
Cinéma Pathé Palace
À sa construction en 1913, le « Pathé Palace » s’impose d’emblée comme le plus grand lieu culturel de Bruxelles. Voulu par Charles Pathé comme un lieu culturel polyvalent, sur le modèle des salles de Music-Hall italiennes, il peut accueillir 2.500 personnes et se compose d’un parterre en deux parties, de deux balcons, de diverses… Continue reading Cinéma Pathé Palace
L’école primaire n°7 à Schaerbeek
C’est en 1874 que le Conseil communal approuve la construction d’une école située rue Josaphat. Les plans sont dressés par l’architecte communal Hippolyte Jaumot. Est alors érigé un bâtiment à rue comprenant un logement pour la direction, complété en intérieur d’îlot par un long bâtiment perpendiculaire au bâtiment à rue. Dans une lettre datée du… Continue reading L’école primaire n°7 à Schaerbeek